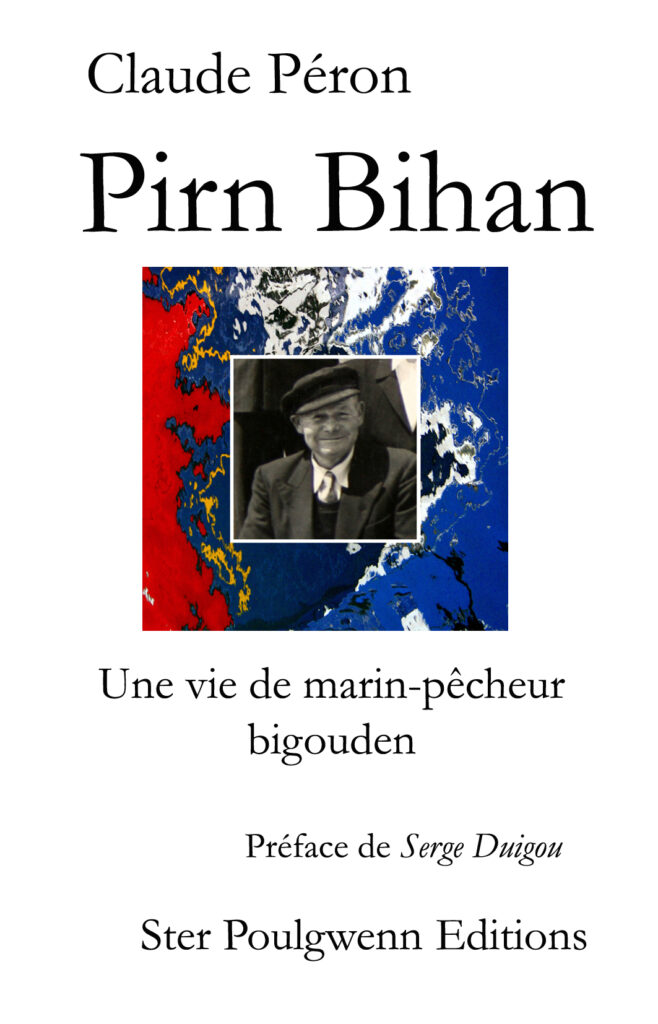
Il est disponible au prix public de 15 € en librairie ou points de dépôt indiqués dans la colonne de droite ou en remplissant le bon de commande (pdf ci-dessous) .
Informations et bon de commande
La une de couverture comporte la seule photo du livre représentant mon grand-père, enchâssée dans une de mes photos de reflets des bateaux du port de Guilvinec.
Lu et entendu dans les médias
Écouter la présentation du livre sur France Bleu Breizh Izel en replay :
en français, l’invité du dimanche matin du 28 avril 2024
en breton, Breizh Storming du 1er mai 2024
Lire l’article d’Anaëlle Berre (Ouest-France – Pays bigouden)
Lire l’article de Pierre Jacquemont (Le Télégramme Pont-l’Abbé)
Voir An Taol Lagad sur France 3 Iroise du 29 mai 2024
Écouter la rencontre avec Manu Méhu sur France Bleu Breizh Izel :
émission Hentoù treuz du 1er juin 2024
